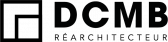Le confinement actuel entrave l’activité habituelle et nous fruste des actions, des contacts et de leur aboutissement économique et financier. Ce fait indépassable est à mettre en relation avec une grande préoccupation d’avant la crise sanitaire. Je n’avais que très peu de temps pour réfléchir au sens de mes activités, trop peu de temps de remise en cause et d’interrogation sur mon rôle d’architecte.
Ce temps de réflexion qui nous est imposé va contribuer à nous ressourcer et à voir le futur, sinon différemment, en chaussant des lunettes nouvelles.
Car le futur, c’est particulièrement le métier de l’architecte. Les bâtiments que nous imaginons et qui sont construits vont déterminer des usages, des paysages, des repères, des émotions pendant des plus de 100 ans. Ceci est vrai depuis longtemps. Cela correspond à plusieurs logiques. Les raisons techniques de la durée de vie des constructions sont liées aux modes constructifs, au système comptable et bancaire en vigueur, à la vitesse relativement lente jusqu’à présent des modes de vie. Beaucoup de références architecturales actuelles sont encore et durablement inspirées du Bauhaus, et je ne parle pas des édifices accueillant les cultes ou les représentations du pouvoir dont le mode d’usage est inchangé depuis tellement longtemps.
Nous sommes d’autant plus sensibles à ce propos que mon agence « réarchitecture ». Ce concept recouvre l’action de redonner une nouvelle vie, un nouvel élan à une construction rendue obsolète économiquement et socialement, mais dont les caractéristiques principales, notamment son emplacement, favorise la stratégie de la conserver.
Notre action, qui consiste en premier lieu à mesurer les nombreuses potentialités de l’existant, principalement la structure et les liens urbanistiques et paysagers avant de le « réarchitecturer », a de nombreux intérêts.
En premier lieu, et pour ce qui nous concerne, le travail sur l’existant apporte un regard absolument différent du projet d’un nouvel édifice. Les expériences synesthésiques des anciens occupants vont nous apporter des informations essentielles pour le bien-vivre dans les volumes dont nous envisageons les reconfigurations. La prise en compte de leur expérience du lieu et de son environnement seront des facteurs de succès de notre intervention. La réarchitecture conduit, en respectant les valeurs et les qualités du bâtiment concerné, à profiter des très nombreuses connaissances liées à sa vie antérieure pour se tourner vers les nouveaux standards d’usage, de sécurité, d’attractivité et d’impact écologique.
Un autre intérêt est justement de réutiliser l’essentiel de la structure, son lot de béton, d’acier ou de bois pour minimiser de manière significative la production d’énergie et de CO2 nécessaire à une reconstruction de même importance. La pollution de la démolition, plus particulièrement sensible dans les lieux touristiques au milieu de territoires fragiles, l’altération, pendant de nombreux mois des abords et des accès au sites et l’énergie pour les remettre en état, l’énergie grise de cette nouvelle construction sont autant de nuisances et de pertes qui sont épargnées par la réarchitecture.
La réarchitecture n’est pas une réhabilitation. Il s’agit d’un travail riche et complet. La construction nouvelle offre une unité, un aspect et des qualités d’usage d’un bâtiment neuf, amélioré des qualités listées dans notre premier paragraphe. Le travail sur le bâtiment qui nous est proposé intègre des modifications, des extensions, des redimensionnements. Il s’agit de remodeler les volumes intérieurs et extérieurs en les faisant évoluer au regard de toutes les modifications de son positionnement urbanistique et paysager comme de celles des attentes ergonomiques.
Alors, dans cette période d’attente, d’incertitude, je me plais à revisiter ces ambitions, d’en évaluer leurs pertinences renouvelées et d’en valider le sens. Je profite aussi de ce temps imposé, sans doute lourd de conséquences, pour mesurer la réalité de mes pratiques.